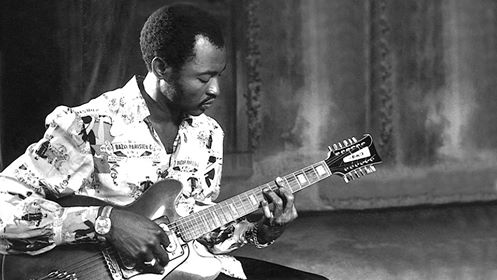Changements climatiques
Les populations de l’arrondissement de Lagdo subissent les effets de la sécheresse et manquent cruellement de ressources pour y faire face.
1- Gounougou entre sécheresse et déforestation
L’arrondissement de Lagdo – lorsque l’on vient de Ngaoundéré- commence au niveau du pont de Mayo-Sala. Il s’étend sur une superficie de 2250 Km2. Sa population avoisine 163.000 âmes. Selon les autorités administratives locales, on y dénombre 110 villages. Parmi lesquels Gounougou. Situé à environ 80km de Garoua, chef lieu de la province du Nord. Il dépend traditionnellement de sa majesté Halidou Tchouto, chef de 3e degré. Ce petit village apparaît au détour d’un virage, à quelques encablures du barrage de Lagdo. Avec ses cases en “poto-poto” et au toit de chaume, Gounougou présente l’image d’un village ravagé. En ce mardi du mois de janvier 2008, il est 10 heures du matin mais déjà, le soleil est haut dans le ciel. Selon une estimation de Care, une Ong internationale, la contrée comptait 2141 habitants en 2006 contre 3150 en 2004. Soit : 1080 de sexe féminin et 1061 de sexe masculin. S’agissant de l’éducation primaire, la même organisation estime à 35,02% le taux d’alphabétisme au sein de la population féminine contre 69,04% chez les hommes. Tandis que le taux de scolarisation est de 67,01chez les filles et de 84,5 chez les garçons. Le taux de ménage ayant accès à l’eau potable est 90,79. L’indice du seuil de pauvreté en 2004 s’élève à 63,2%, contre 100% à Bessoum, un village voisin.
Au regard de ces statistiques, cette contrée semble bien lotie. Et pourtant…Le chef ne se fait pas prier pour énumérer les problèmes rencontrés au quotidien par ses sujets. Ce sont entre autres, la sécheresse et la déforestation. Ces maux, véritables gangrènes, sont difficiles à éradiquer malgré l’assistance des bailleurs de fonds tels que Care, Wwf et le Programme national de développement participatif (Pndp), etc.
2- Corvée de bois au féminin
“ Avant, cette tâche était réservée aux enfants. Mais à cause de la distance qui a doublé et les dangers que représentent les coupeurs de route, ce n’est plus possible ”, indique Alima, vendeuse de farine de maïs. Pour la cuisson des repas, cette mère de famille se ravitaille chez les ramasseuses. Ici, le prix dépend de la grosseur du bois. Par exemple, pour avoir 4 ou 5 maigres morceaux de bois d’un mètre, il faut débourser 100fcfa. Elle se souvient qu’il lui est arrivé de ne pas cuire des aliments à cause du manque du bois de chauffe.
Pour arrondir ses fins de mois, Amina (27 ans) a fait du ramassage et de la vente du bois de chauffe, son activité principale. Bravant des obstacles innommables. A force de travail, elle ne fait plus son âge. Tous les jours, depuis bientôt un an, cette mère de famille quitte son domicile à 6 heures à la recherche du bois. Pour approvisionner sa clientèle, elle parcourt entre 5 et 6 km voire plus. Au terme de ce voyage semé d’embûches, 10Kg de bois de chauffe composés de brindilles sèches ramassées çà et là tout au long de son parcours. Le fagot si durement constitué est revendu au détail. Il lui rapporte 500Fcfa tout au plus. Mère de quatre enfants, Amina avoue s’être lancée dans cette activité pour sa progéniture. “Je n’avais rien à faire ”. Les ressources issues de la vente du bois de chauffe lui permettent de résoudre quelques problèmes. Mais il y a des jours où elle revient bredouille. N’est-ce pas trop fatigant ? Si, çà l’est répond Amina. Qui s’empresse d’ajouter qu’elle n’a pas de fonds pour ouvrir un commerce. Son époux, pêcheur a du se reconvertir dans l’agriculture à cause du manque de poisson dans le fleuve. Cette nouvelle activité ne rapporte pas grand-chose non plus.
Sécheresse
Au village, les populations accusent la sécheresse, elle-même liée à l’avancée du désert. Les climatologues y voient les effets du réchauffement de la terre. Ses conséquences se ressentent dans tous les secteurs d’activités. Selon sa majesté Halidou, depuis quelques années les cultivateurs assistent impuissants à la baisse des récoltes. La production du riz, maïs, mil, sorgho, coton, arachide s’est réduite au fil des ans. En 2007, ce paysan a sur un hectare, récolté 30 sacs de maïs contre 40 en 2006 soit, 10 sacs en moins. Il estime sa récolte de riz à 40 sacs contre 60 à 70 les années antérieures. La production halieutique est quant à elle passée de 20.000 tonnes en 1984 à moins de 5000 aujourd’hui. A cause de “ la forte pression des migrants, qui fuient la chaleur de l’Extrême Nord, les choses risquent aller s’empirant si rien n’est fait ”, prédit-il.